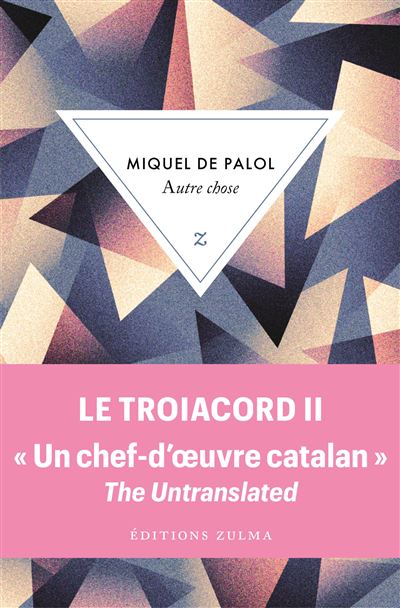
Métaphysique d’une quête, aussi mathématique que philosophique, d’un au-delà des apparences, d’une perception ludique, manipulée sans doute, absolue aussi, du temps, du récit et de ses enjeux politiques, qui d’abord passe par une passionnante enquête historique sur les loges franc-maçonnes tout au long du XIXe siècle et sur leur représentation du monde dans un jeu d’échecs tri-dimensionnel. Miquel de Palol nous entraîne, ensuite, dans une érudition littéralement folle, ébouriffante, parfois jusqu’à une impression de précipitation qui, néanmoins, interroge le vide, sinon le nihilisme, derrière les belles, profondes jusqu’au cynisme, discussions de ces conceptions si élaborées qu’elles semblent libertines, porteuses en tout cas d’une pertinente spéculation éthique : interroger le statut, ses représentations et désirs de totalité, de la réalité revient à vouloir, fût-ce dans un jeu aux contours et pratiques encore flous, à l’imposer. Autre chose, au titre si révélateur, deuxième tome du Troiacord, surprend toujours le lecteur par sa capacité à brasser toutes les interrogations qui, telle une architecture baroque, ont construit le roman.
En ce moment, sans doute aussi en réaction assez claire au contexte, nous voulons du complexe, de la densité, de la littérature qui spécule sur son impossibilité, qui dès lors tente d’organiser autrement son récit. Pour évoquer ce livre si riche, plein de zones d’ombre, de non-dits, de pistes aussi pour les trois autres volumes à venir, de liens avec le précédent Troiacord, voire avec Le jardin des sept crépuscules ou avec Le testament d’Alceste, commençons par explorer une de nos interrogations du moment : pour véritablement se construire, approfondir et dédoubler son récit, en mirer et en réfléchir possibilité et finalité, il me semble de plus en plus (comme si cette conception ne pouvait d’ailleurs être que le retour d’une intuition, autrement creusée) que le roman ne peut se concevoir que face, avec la distanciation et l’émancipation qui toujours le caractérise, à un discours d’accompagnement, des théories qui en dessinent l’arrière-monde, rendre, qui sait, partageable sa vision forcément particulière, et commune malgré tout, d’une réalité. Comme dans tous les romans de Miquel de Palol ce sera la géométrie. Le vrai plaisir de parler de littérature contemporaine reste de pointer des intuitions, de n’avoir point à les vérifier. On aime énormément la possibilité que les cinq volumes du Troiacord vont probalement former une très savante figuration géométrique, sans doute un dodécaèdre (allez voir ici si vous voulez vous en faire une idée), d’autres contingences, d’autres proximités, une autre forme de récit et donc de temporalité, quelque chose d’aussi fou, grand, que de « retrouver l’accès au modèle originel, à une vision non chronologique, non séquentielle, non discursive de la réalité. » Qu’est-ce à dire ? Là est toute la question. Autre chose, sans doute, toujours. L’autre discours d’accompagnement sera alors ces morceaux de phrases (dit-on des hémistiches dans la poésie grecque ?) de L’Iliade qui ouvrent chaque chapitre qui se relieront de volume en volume, je crois.
Nous acceptons, perpétuellement frustrés par le biais d’une expression réticente, notre impuissance à dire l’ineffable, voire à s’en approcher et, toujours à la limite du vide, comme objectif, danger ou consolation, nous nous résignons avec mélancolie à cette impossibilité, qui atteste pieusement de la perpétuation d’un tel manque.
Tentons d’être, un tout petit peu, plus claire. Autre chose, ce sera d’abord la surprise, ce second volume semble d’abord incarné tout autre chose que le premier, Trois pas vers le Sud. À l’instar du Testament d’Alceste ou du Jardin des sept crépuscules, nous retrouvons la veine de Miquel de Palol : des puissants qui dissertent, se racontent des histoires, prétendre ainsi changer l’ordre du monde, sans doute aussi faire perdurer leur domination. Ce sera d’ailleurs l’aspect dont on vous parlera le moins : Autre chose est un roman radicalement politique, une mise à la question d’une possible emprise sur la réalité, sur le discours du moins qui la façonne. Pour aborder brièvement cet aspect, à nouveau il nous faut nous confier au vide. Un roman aussi pleinement baroque que le Troiacord ne peut ne peut se former que sur l’anamorphose, sans cesse des discours qui montrent autre chose, le taisent, en suspendent autant la révélation que le probable manque de sens. Un jeu au bord du vide, une spéculation au seuil de la disparition, une méditation aux confins de l’inanité : le roman. Je crois qu’une histoire structure ce récit des illusions du récit : un nécromancien promet à un jeune naïf qu’il pourra conquérir toutes les femmes qu’il veut, celui-ci refuse de le payer, veut avoir une femme plus séduisante. Bien sûr, le nécromancien ne fait que transformer les chats de ce candide. Que se passerait-il s’il refusait de payer, se retrouverait-il, quand même avec ses trois chats, gros Jean comme devant ? Ne se produirait-il rien puisque ce payement, cette créance, reste condition sine qua non du récit. Avec sa verve habituelle, le Jeu qui sera, je pense, sans cesse mis en branle, en doute, dans Autre chose tient aux impossibilités structurelles du récit. Ou pour le dire en terme plus prétentieux, avec l’ironie, la géométrique polyphonie, dont fait preuve Miquel de Palol pour énoncer ce qui serait, dans une illusion d’optique, dans une vision unilatérale, une des ambitions de son grand-œuvre : « Plus loin encore : l’art qui dit la nostalgie de l’impossibilité pour l’art, ou pour tout autre langage, de rendre compte de l’expérience transcendante. » Cette expérience transcendante serait, comme pour Damià, le personnage, pour ne pas dire la doublure, de Trois pas vers le Sud, serait, le plus simplement, vulgairement possible, d’éprouver une temporalité où, dans le récit du moins, le temps n’existerait pas, il y aurait simultanément quelque chose et rien, on serait acteur et spectateur. Tout ceci passant dans un très curieux, un rien opaque, enroulement des faits, un vol de livres qui s’inscrit dans autre chose, pourrait tout aussi bien ne pas avoir eu lieu, au milieu, nous sommes à l’évidence dans un roman de Miquel de Palol, d’orgie, de manipulations dont il faut bien se demander qui en est le dupe. Hormis le lecteur quand, comme moi, il prétend rendre compte des figurations plurielles dans lesquelles il se trouve heureusement emprisonné.
Où est passé l’héritage du drame de la Cité Idéale, de cette abondante géographie de la bonté, des équilibres des intérêts, de fluctuations des tendances, des épanchements d’affections, des réalisations des désirs, des nœuds conceptuels ?
Sans doute dans la réalité hermétique dont ne cesse de se jouer Autre chose. Reprenons autrement, nous ne savons guère faire autre chose. Il faut dire la très grande fascination que va faire naître l’enquête, opportunément, confier à Jaume Camus, ce jeune homme à qui l’on demandera de reprendre une recherche sur ce qui, dans les sociétés secrètes du XVIII et XIXe siècles se nommait le Jeu de la Fragmentation. Celui-là même qui occupait les décadents, libertins, participants du Testament d’Alceste. Nous serons ici confrontés à la naissance illuminée des proto-sciences, aux rites et autres magies, tromperies plus ou moins volontaires de ces francs-maçonneries et autres illuminati. Risible et attirant désir de totalité. Il me semble que ce à quoi Miquel de Palol tente de donner une forme serait l’athéisme intégral. Toujours face cette certitude : « Un pas de plus, et le fond de la question est vide. » La tentation d’en faire un peu trop, l’excès, la très grande rapidité de ce roman qui parfois perd un rien le lecteur, lui fait confondre les personnages réduits à des silhouettes, à leurs négations toujours bienvenues, toujours radicalement ambivalentes, de toutes morales. Car, bien sûr, toujours il s’agit de les mettre en discussion, d’en souligner les perversions, de mettre en récit leur danger, de ne surtout rien céder à l’inexplicable : « Vouloir expliquer l’inexplicable en le soumettant à une contemplation dévote, c’est vouloir au bout du compte que l’inexplicable cesse de l’être, ce qui pratiquement fait de l’Église une machine à tuer le progrès et le bien-être. » Toujours penser que l’on puisse décrypter les stases menteuses de la réalité ; continuer à croire un peu moins mal se leurrer. Jaume est donc, si vous me suivez encore à peu près, de lire une correspondance qui serait trop ennuyeuse pour ne pas être allusive, mettrait en jeu d’adultérines révélations, suggéreraient la participation à ce Jeu dont, on l’aura compris, on ne saurait saisir que d’extérieures représentations. Par la bande, cette évocation se révèle captivante, parfois un rien échevelée, un peu rapide ou désincarnée peut-être. Radicale remise en question, aussi, de l’incertitude historique dont le récit accompagne la naissance. Toujours intéressant, je pense de voir les liens entre les Lumières et l’occultisme, entre le progrès et une croyance rationnelle. De l’utopie ou mysticisme, Miquel de Palol interroge sur l’Absolu et les substitutions qu’on lui trouve. On navigue, vous l’aurez entendu, en pleine abstraction, au seuil, répétons-le, de ces questions philosophiques qui ont formé le roman. Autre chose cependant parvient souvent à en suggérer une forme, une figuration pas seulement allégorique de ce « Jeu littéral, le Jeu avant la réalité, le Jeu après la réalité… comme s’il était possible de tout séparer, comme si la réalité pouvait contenir autre chose qu’elle-même. » À plusieurs reprises, l’auteur parle d’une réalité iconique, une qui ne pourrait s’incarner que dans des représentations : trompe-l’œil autant qu’anamorphose. Jaume, candide protagoniste qui se croit lucide par son érudition, comme dans le conte donc du nécromancien, rencontrera trois femmes : Spiglia, Ummaguma et Francesca. Leurres : dévoiements autant que de dévoilements. Une chose en cache, à l’évidence, une autre. On devine que derrière ses recherches, outre une façon de réactualiser le jeu, Jaume tente de démêler des questions d’héritage, de lumineux et rentables procédés d’optiques. Nous retrouvons alors la famille de Max Van Eglemont, les jeux d’alliances comme manière d’autrement recomposer la réalité. On notera le procédé plutôt habile de Miquel de Palol : on livre soudain à Jaume, une ébauche d’arbre généalogique, ce qu’il révèle s’avère sans doute infiniment moins important que ce qu’il occulte. D’incertaines paternités, de complexes interdépendances dont nous n’aurons qu’une ébauche, un fac-similé bien sûr peu évident à déchiffrer et décisive pour les trois autres tomes.
Une phrase sans logique […]. Ou du moins dont la logique est souterraine, contenue. Il ne s’y passe rien, il n’y a pas d’histoire, pas d’anecdote, pas de contenu, comme dans la vie.
La révélation, malgré tout, tiendrait peut-être dans une phrase, dans sa recomposition ferait sens, enfin en ouvrirait un ultime. On peut parfois penser que tout à son travail de composition, d’agencement et d’illusion, le style de Miquel de Palol semble un rien limpide, le plus simple possible pour nous faire entendre le haut degré d’abstraction de son récit. Ne nous y trompons pas, là encore un trompe-l’œil, habile manière de suggérer tout ce que l’on cache, combat contre le vide, des bribes de sens qui agencées donnent l’illusion d’un sens. Dans une tradition littéraire très établi, Miquel de Palol le fait ici par l’échange de poèmes cryptiques, possiblement plein d’allusion, possiblement tout autant apocryphes. On aura, au moins, un semblant d’explication du sens du titre Trois pas vers le sud. On attend la suite avec impatience pour continuer à autrement se tromper.
Un grand merci aux éditions Zulma pour l’envoi de ce roman.
Autre chose, le Troiacord II (trad : François-Michel Durazzo, 357 pages, 11 euros 50)
Découverte d’un auteur dont cette présentation me donne envie de lire … pour commencer le premier tome de ce « chef d’oeuvre » (sourire)²
J’aimeJ’aime