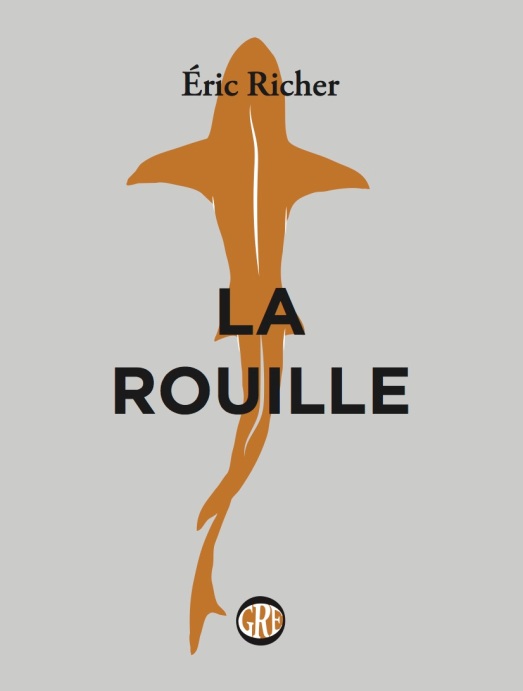
Quels mots mettrent sur nos catastrophes intimes, sur nos façons de ne pas nous laisser ankyloser par la rouille ? Quelles phrases agencées pour donner à voir la violence, et ses impensés, d’une vision adolescente qui réfute tout rite initiatique comme autant de récits inopérants, d’un autre temps ? Dans une prose si syncopée qu’elle sinue entre les hallucinations, Éric Richer nous entraîne dans La rouille dans son univers si singulier, inquiétant. Un premier roman plein de promesse.
Pour tracer une généalogie hasardeuse des publications des si indispensables Édition de L’Ogre, La rouille pourrait paraître une continuité inversée, masculine autant que l’autre était intimement féminin, de Brûlées d’Arriadna Castellarnau. On retrouve dans ces deux romans une atmosphère post-apocalyptique, une survie dans l’insignifiance et sa violence. La ressemblance s’arrête-là. À moins de reconnaître à tous les livres de cette maison d’édition une forte aptitude à nous désappointer, à transmuer le récit en ordalie comme si oniriquement le faisait La maison des épreuves.
Des rapprochements qui ne nous apprennent rien. Maigre palliatif à la difficulté à évoquer ce livre. Être à ce point insaisissable reste un aspect de plus positifs. Je ne saurais dire que j’ai aimé ce livre. Là n’est en aucun cas la question. Éric Richer sait nous le rappeler : un livre qui ne vous laisse pas mal à l’aise face à la violence, incertain de la coupable jouissance prise au spectacle peu ragoûtant, serait, à mon sens, une dégueulasserie complaisante.
L’univers de La rouille d’abord désappointe. Aucun exotisme dans ces lisières post-soviétiques. Un monde déglingué, des ferrailleurs au milieu d’une casse. Loin de tout quand les seuls repères géographiques demeurent sans référence. Contemporain pourtant pour nous rappeler que la catastrophe déjà a eu lieu. Ce monde mécanique, sur le papier, présente peu d’attrait à mes yeux. La puissance des moteurs, l’exaltation de la vitesse, des combats retransmis par des internets filandreux… Des hommes entre eux. Alcool. Défonce. Vantardise. Solitude surtout. Parfois des spoutnik, éphémère présence russe. Nous ne sommes pourtant pas proche de l’univers de Nami. Les noms de lieux ne renvoie à rien. Notons, sans en tirer argument, le flottement d’une erreur volontaire. Une somme indiquée en euros. Penser alors à Mac et son contretemps de Vila-Matas où un auteur prétend, plus tard, pour son premier roman, avoir truffé son texte d’incohérences volontaires, de passages ratés.
Un reproche que l’on ne peut adresser à Éric Richer dans son premier roman est cohérent et audacieux. Un des angles de lectures le plus spontané me semble le récit d’un effondrement du langage. On pourrait presque se demander si cela, à l’occasion, ne vire pas à l’automatisme dans La rouille. Abus peut-être de phrase nominale, d’une succession de vision syncopée. Les détails ne s’agencent plus vraiment maintenant que la langue est réduite à un globish marchandisé. Agaçant le recours aux anglicismes. Révélateur ensuite insidieusement.
Nói vit dans un coin fictif, sans langue propre. Érich Richer, dans une prose souvent très belle, inventive, brisée, audible sait nous le rendre. Toute la valeur de cette prose, hormis des passages de bravoure, des moments nombreux de purs fulgurance, est de ne prendre aucune hauteur face son personnage paumé et camé. Si, a priori, je ne goûte guère une plongée dans le monde des ferrailleurs c’est en partie par la hauteur sociologique que trop souvent ce traitement reçoit. Une valorisation un peu crade de la marginalité. La rouille suit le sillage de son personnage, croit en ses délires, suit ses errances sans les jauger.
Hormis celui capital de la phrase (il impose sa tension, exaltations et mauvaises redescente, fuite et confrontation au réel), Éric Richer sait nous imposer celui qui jouera avec un ennui du lecteur. D’abord récit réaliste d’un univers parfaitement fictif, La Rouille retrouve ensuite le rythme primaire des narrations primitives. Nói s’accroche à son refus de subir le Kännöst, tout à la fois cérémonie barbare et ultimes reliques d’une tradition à la con pour mâles désœuvrés (qui à dit qu’il n’en existait guère d’autre, qu’on fondait des religions sur moins que ça ?), « moment des ardoises effacées, des secrets éventés. » Une façon surtout pour l’auteur de nous déstabiliser. Le récit s’entrecoupe de chapitre en italique, autant d’improbables reconfigurations de cette nuit initiatique minable.
De cet univers frustre, où sans se nettoyer on sniffe tous les détachants possibles, Éric Richer sait pourtant déceler une tendresse enfouie. Dans ses visions Nói poursuit sa mère. Il l’a rejoindra comme on livre la clé d’une hallucination. Dans cet univers égaré, le nôtre quoique l’on essaie de se faire croire, les personnages se révèlent dans leur faille. Pour n’en livrer qu’un exemple. Le grand-père tyrannique sait la valeur, pour les hommes comme pour les chiens d’une expéditive euthanasie quand la rouille ankylose.
Tenter de l’aventure de la lecture de ce livre étrange, froid et pisseux comme le soleil d’une ivresse matutinale.
Un immense merci aux Éditions de l’Ogre pour l’envoi de ce roman à paraître le 23 août.
La rouille (372 pages, 21 euros)
Un commentaire sur « La rouille Éric Richer »