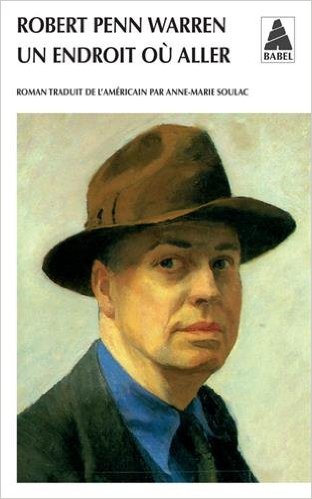
Robert Penn Warren est un auteur peu connu en France. Dans Un endroit où aller, il nous livre une grande fresque pleine de drôlerie et de profondeur. À travers le destin de son héros, l’auteur interroge avant tout la perception de ce que nous pouvons devenir.
je pris conscience que je m’étais accroché à cette notion d’irréalité de leur univers parce que je ne pouvais pas affronter la pénible réalité de leur joie.
Le seul rapport à l’écriture est celui qui met la réalité en jeu. Michel Leiris donne ainsi une nouvelle définition de son exigence d’introduire dans la littérature ne fut-ce que l’ombre d’une corne de taureau. Plus qu’un rapport à la langue, une écriture qu’il est facile de déconsidérer, un roman me semble acquérir sa cohérence dans cette remise en cause de cette réalité. Infiniment castrateur de croire qu’elle va de soi.
L’approche de la réalité tient alors a la capacité d’un auteur à en saisir les similitudes, à l’inscrire dans un thème connu, des lieux communs plutôt que des passages obligés. Ce livre nous raconte, lui aussi, une histoire d’adultère. Le héros prend conscience de la réalité de cet amour seulement en le ramenant au thème de l’amour courtois. La singularité de l’amour est de nous laisser croire à l’inédit quand nous répétons les mêmes gestes et peinons à reconnaître les mêmes sentiments mille fois décrit.
L’évocation de la seconde guerre ajoute de la densité à ce roman qui parfois paraît s’enfoncer dans le passage obligé de l’adultère. Sans prétendre à une vaine originalité Penn Warren y trouve pourtant l’excuse idéale pour déployer l’histoire spéculative au centre de l’appréhension de tout personnage romanesque.
Jed Tewksbury se trouve confronter à l’absence, autre sujet au cœur de l’invention romanesque. Une certaine proximité avec Proust, ne fut-ce la clarté de ces détails charnels où le narrateur tente d’attacher la nudité de l’amour, dans cette manière dont la jalousie suffit à susciter l’invention amoureuse de l’autre. Désir de voir l’être aimé dormir, prurit de le représenter avec cette réalité qui survient et s’impose dans sa nudité houleuse. Et déjà goût de la perte, entretien du souvenir de la première rencontre dont le narrateur ne cesse de déployer le sens. Jed revient sur l’humiliation de sa première rencontre avec Rozelle. Jamais il ne décide si son protagoniste a précipité ce fiasco ou s’il a subit la première manipulation de cette femme manipulatrice et fascinante.
Une des grandes réussites de ce livre reste la façon dont l’auteur confond les époques. Il ne cesse de déceler des révélations, des savoirs enfouis, des presciences refoulées dans ce qu’il vit. Penn Warren analyse finement les récurrences des amours de son personnage au point que chaque femme paraisse une silhouette vite noyée sous l’incapacité de son protagoniste à en saisir la réalité, à s’intéresser uniquement pour ce qu’elle est. Mais, qui le peut vraiment.
On dit ce roman le plus autobiographique de cet auteur dont j’ignorais tout jusqu’alors. En tout cas, il me paraît traiter la dérision irréelle et cruelle du monde universitaire avec cette pertinence qu’il est aisé de laisser entendre dû à un vécu personnel. Jed joue la comédie de rédiger une thèse, d’ajouter du savoir à du savoir. La poursuite de la vanité semble le seul destin de Jed. Alors qu’il pensait y trouver un imperium intelectus, une contrée, voire une inavouable communauté. Ceux qui sont passé par l’université reconnaîtront la pertinence de la description, ceux qui s’y sont attachés refuseront probablement de voir l’exactitude avec laquelle Penn Warren décrit la résignation qui y règne. Précisément cette irréalité qui ose prétendre que tout va de soi. Une nouvelle coupure à laquelle le héros réagit en se livrant, comme une caricature dont le livre abonde, à un engagement politique, une vie mondaine, artistique puis familiale. Des effort vertueux pour rejoindre la communauté humaine dont Jed ressort soudain avec l’impression d’être enfermé. Nouveau portrait saisissant de ce que le narrateur nomme son programme de bonheur et qui ressemble fort à nos tristes vies.
Ainsi je me suis habitué à la solitude. Ou, plus exactement, je l’ai emplie.
Si le héros paraît d’abord un homme creux, velléitaire et se laissant porter dans cette mondanité riche et détaché du matériel dans laquelle si souvent la littéraire pioche son irréel matériaux, il paraît attachant par ses hésitations seules à mêmes de rendre l’aspect composite de la réalité. Souvent, ses sensations et ses sentiments apparaissent dans de limpides contradictions : la réalité du mensonge, l’ambiguïté de sa maîtresse meurtrière et des répulsions de son attraction.
Malgré son envahissante culture classique (bien sûr proposé comme une caricature de la possibilité d’un endroit où revenir), Jed a la splendeur des grands personnages romanesques par l’absence d’aigreur de son traitement, par les idées plurivoques qu’il incarne, par cette innocence qui ne cesse de l’animer. Par sa formation, par son caractère éminemment humain et sympathique, Jed ne cesse de chercher autre chose. Cet endroit où aller est peut-être un leurre. À l’image de ce mari trompé qui incarne le deep south, Mr Nashville lui-même, mais qui reste un artiste manqué peut-être par la satisfaction de son appétit sexuel. Penn Warren est trop malin pour nous proposer une solution.
Le hasard de mes lectures me confronte en ce moment avec cette idée du roman national. Un thème qui me dérange au fond tant il semble propice aux anathèmes et aux réductions de généralisations excluantes. Jed est rejeté. Sa mère insiste pour qu’il ne revienne pas dans sa ville natale, qu’il s’éloigne de toutes ses pesantes mythologies. Penn Warren interroge alors cette part de nostalgie, de ce mal du pays qui se moque des frontières géographiques. L’endroit où aller est peut-être alors celui où continuer à s’interroger sur la possibilité de ne pas se soumettre aux racines, de trouver un lieu à soi, voire d’incarner la prétention d’être au monde. Une part de moi, pourtant, se cabre devant ce type de tropisme :
Nous sommes simplement en proie aux premières affres du modernisme, affirma-t-il, la mort de ce moi en nous qui n’a plus d’attaches avec un lieu.
À tout prendre, je préfère ce genre de phrase qui décrit l’impossibilité infernale (bienvenue pour le spécialiste de Dante qu’est le protagoniste) de tout retour, cette impossibilité de posséder un endroit pour mourir. Ce fantasme de retour, Ken Kesey l’explore comme un mythe fondamental des États-Unis, celui qui frappe cette nation d’abord fondé sur l’errance, vers l’Ouest d’une terre toujours promise. Quand, Jed revient vingt-cinq ans après la mort de sa femme dans la ville qu’elle n’aurait jamais dû quitter, l’auteur lui fait prononcer cette phrase admirable, juste avant de conclure son roman sur son retour en Italie, sur les terres de son expérience de la guerre :
Il n’y avait pas de place pour moi dans le cercle enchanté autour de l’enfant qui ne grandirait pas.
Au lieu d’exposer son héros à un retour, à ce conservatisme dont Penn Warren fut adepte dans sa jeunesse sudiste, le romancier à la grâce de l’exposer à un retour en terre. Plus que son passage en Italie où il retrouve ses anciens compagnons réticents à évoquer le passé, davantage que le retour de son premier amour qui s’acharne à être la plus belle du lycée, le romancier interroge la possibilité de revenir sur les terres maternelles. À la mort de sa mère, Jed revient dans son village d’enfance, il contemple une tombe sans parvenir à lui accorder la moindre signification décisive. Un endroit où mourir reste une possibilité qui est caricaturé : Jed clôt son histoire par un vain pèlerinage à l’endroit où son père, ivre mort, a chuté débraguetté.
La force de ce roman va jusqu’à m’inspirer une sorte de réticence face à cette grande fresque américaine dont, une fois de plus, cette brève note est loin d’épuiser le sens.